Notre contribution au débat public des EPR de Gravelines
Nous publions ci-dessous la contribution de Pôlénergie aux cahiers d'acteurs dans le cadre du Débat Public qui vient de s'achever.
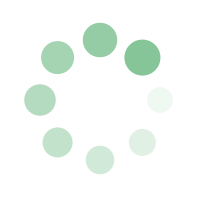
Nous publions ci-dessous la contribution de Pôlénergie aux cahiers d'acteurs dans le cadre du Débat Public qui vient de s'achever.
Retrouver l’ensemble des contributions ici. Les deux EPR de Gravelines s’inscrivent dans une vision stratégique pour répondre à la demande croissante en électricité liée à la décarbonation et à la réindustrialisation. Implantés au cœur du dynamisme industriel de Dunkerque, ils soutiendront des entreprises électro-intensives tout en attirant de nouveaux projets innovants.
Au-delà du local, ces réacteurs sont cruciaux pour les objectifs régionaux de neutralité carbone et d’autonomie énergétique d’ici 2050. Avec une production régionale devant doubler (passant de 55 à 109 TWh/an), et malgré les gains d’efficacité et de sobriété, les besoins en électricité continueront d’augmenter (électrification, gigafactories, et peut-être e-carburants ou H2).
Face à ces enjeux, et sur la base de calculs réalisés grâce à un outil développé par Pôlénergie, nous sommes enclins à penser que le véritable besoin se situerait plus autour de trois EPR. Cette ambition permettrait de sécuriser les besoins futurs, d’éviter une sobriété subie, de renforcer l’attractivité régionale et de positionner les Hauts-de-France comme un leader européen de l’énergie décarbonée. Les EPR ne sont pas seulement une réponse aux défis régionaux mais un enjeu national et européen, garantissant une production compétitive et souveraine d’électricité bas-carbone. Ambition énergétique, ambition de décarbonation et ambition de réindustrialisation doivent s’articuler.
Les EPR : une clé pour la réindustrialisation de notre Région
Les projets de 6 EPR en France (Penly, Bugey et Gravelines) correspondent à une vision globale qui vise à compléter et parfois remplacer les installations nucléaires historiques mais surtout à faire face à une demande accrue d’électricité en France, conséquemment à la décarbonation de notre économie, synonyme bien souvent d’électrification, et à sa réindustrialisation. Fort de cette vision, les deux EPR de Dunkerque sont tout à la fois un enjeu local, régional, national et européen.
Les deux EPR de Gravelines entrent tout d’abord dans une vision territoriale locale de consommation et production. Situés sur la zone industrielle du grand port maritime de Dunkerque, près de la centrale historique de Gravelines, ils contribueront à la fourniture électrique des industriels électro-intensifs existants mais aussi des nouveaux projets industriels en cours de construction.
 Parmi les électro-intensifs :
Parmi les électro-intensifs :Grâce à ce surcroît d’énergies apportées par les EPR et à côté des autres ressources énergétiques (terminal méthanier, ENR dont l’éolien off-shore, le biométhane où la biomasse) ainsi que des réseaux qui en découlent – électriques, CH4, chaleur et bientôt H2 et CO2, Dunkerque disposera désormais d’un dispositif énergétique encore plus attrayant, capable de dynamiser l’installation de projets énergétiques nouveaux d’envergure : les gigafactories de batteries en sont déjà le témoin mais l’avenir pourra confirmer cet attrait à travers l’arrivée de projets de chimie fine et SAFs, élargissant ainsi la vocation du port centrée sur le container.
Sur un plan régional, les deux EPR se justifient tout autant, face à une analyse des consommations. La Région Hauts-de-France est engagée dans une transition énergétique ambitieuse avec des objectifs à l’horizon 2050 centrés sur la neutralité carbone, la réindustrialisation et l’autonomie énergétique. Les EPR sont une condition nécessaire à la réalisation de ces objectifs (doublement de la production régionale, passant de 55 à 109 TWh/an). La réduction de la consommation énergétique (de 200 à 102 TWh) via la sobriété et l’efficacité énergétique, ainsi que l’augmentation du renouvelable doivent aussi y concourir. Le rôle de l’électrification se veut ainsi massif.
Une planification nécessaire au juste dimensionnement de la production, de l’efficacité énergétique et de la sobriété.
Face à ces objectifs ambitieux, la planification énergétique est nécessaire. C’est pourquoi Pôlénergie a développé un outil qui propose une approche intégrée et systémique de tous les flux énergétiques à horizon 2050. Cet outil permet de suivre les avancées concrètes sur le terrain et offre des arguments objectifs sur les arbitrages à poser. C’est donc un outil de pilotage politique de la transition énergétique. à partir de cet outil, nous reproduisons, ici, la vision des flux d’électricité de la Région Hauts-de-France à horizon 2050 :
Ce diagramme est à challenger pour plusieurs motifs. Il quantifie en effet les données du SRADDET de la région Hauts-de-France qui prévoit une réduction par deux des consommations régionales finales, passant de 200 TWh à 102 TWh par l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique.
L’efficacité énergétique se gagne par la permutation vers des appareils moins énergivores qui réduisent le besoin énergétique. Ce gain en consommation énergétique ne signifie pas directement un gain en consommation électrique : bien souvent l’efficacité énergétique conduit également à une permutation d’installations utilisant des énergies fossiles à des installations électriques. In fine, la consommation électrique augmente (exemples : pompe à chaleur vs. chaudière gaz, véhicule électrique vs. véhicule thermique, etc.).
La sobriété énergétique, quant à elle, vise à une transformation des comportements. Chez les particuliers par exemple, les plus gros usages énergétiques sont le chauffage et le transport : non seulement la réduction du nombre de kilomètres parcourus par an ou la baisse de la consigne de chauffe n’est pas acquise, mais qui plus est ces deux usages sont encore peu électrifiés. Par ailleurs, certaines consommations électriques sont incompressibles (tout comptable a besoin de son PC, une industrie ne peut tourner à moitié pour un même volume produit, un réfrigérateur doit maintenir ses températures correspondant aux normes sanitaires, etc.). L’objectif d’atteindre 30% de sobriété nous paraît à ce titre particulièrement difficile à atteindre.
Ainsi, que ce soit par l’efficacité énergétique ou la sobriété énergétique, paradoxalement, une réduction de nos consommations ne signifie pas un besoin réduit en électrons. Voilà pourquoi dans les Hauts-de-France, notre modèle passe d’une consommation de 45 TWh en 2019 à 62 TWh en 2050 ; phénomène loin d’être isolé puisque parallèlement, la SNBC annonce passer sur le plan national d’une moyenne 2014-2019 de 475 TWh à 600 TWh en 2050.
Un impact national et international conséquent
Lorsque l’on parle de production d’électricité, c’est bien-sûr à la maille nationale, voire européenne qu’il faut analyser les disponibilités, dans la mesure où la densité des lignes HT, les interconnexions nous rapprochent toujours un peu plus de la plaque de cuivre idéale qui permettrait le transfert d’un électron partout en Europe de manière instantanée. Ainsi, en 2024, la France a atteint un nouveau record d’exportations nettes d’électricité, surpassant ainsi les niveaux de 2002, avec 83 TWh d’énergie décarbonée livrée à nos voisins.
Il faut ainsi s’assurer que certaines régions fassent une part d’effort plus importante pour couvrir les besoins du bassin parisien structurellement déficitaire et de nos voisins largement carbonés ou dépendants d’énergies intermittentes.
Pour les Hauts-de-France, il s’agira de produire environ 60 TWh à l’horizon 2050. L’hydraulique n’est pas mobilisable dans notre région, le solaire représente 350 GWh en 2021 et sera multiplié par 10 d’ici 20501, soit 3,5 TWh, l’éolien offshore représentera 2,5 TWh avec le champ de 600 MW au large de Dunkerque, enfin, l’éolien terrestre représente 12 TWh aujourd’hui (première région française) et présente peu de marges de progrès pour les raisons d’acceptabilité que l’on connaît.La centrale nucléaire de Gravelines produit 32 TWh avec ses 6 réacteurs totalisant 5400 MW de puissance, mais toute la question est de savoir de combien de tranches l’ASN demandera la fermeture d’ici 2050.
En tablant sur une fermeture de 2 tranches2, il reste donc a minima 23 TWh à couvrir auquel l’éolien ne pourra suffire, sauf à croire au triplement de sa production d’ici 2050 dans le contexte évoqué ci-dessus. La production de deux nouveaux EPR est donc vivement souhaitée d’un strict plan régional. L’un d’entre eux se justifierait déjà pleinement rien que pour le dunkerquois. En parallèle, il ne faut pas sous-estimer l’apport des SMR qui présentent l’avantage de venir soulager les réseaux électriques existants.
3 EPR, plutôt que 2 ?
Les calculs que nous produisons sont dérivés, comme nous l’avons dit, du SRADDET qui a travaillé ses chiffres à iso-structure. Il faudrait donc tenir compte d’un accroissement de la population, de la réindustrialisation qui compte aujourd’hui des électro-intensifs, notamment les 6 gigafactories de batteries. Quels seront les besoins de demain, si la région développe comme nous pensons qu’elle devrait le faire des unités de production de e-SAF et des produits dérivés de l’H2 électrolytique ? Alors que nos voisins du Benelux développent une économie de l’hydrogène basée sur l’importation et permettant d’alimenter leur industrie lourde ainsi que celle de l’Allemagne, ne pourrait-on pas penser que les Hauts-de-France pourrait grâce à une électricité bon marché jouer la carte de la production massive d’hydrogène décarboné pour l’exporter et développer une industrie solide des dérivés de l’hydrogène (ammoniac, méthanol, e-kérosène, etc.) ? Reste enfin l’export d’électrons, dont le bénéfice est toujours souhaité grâce aux interconnexions inter frontalières dont notre pays, et en particulier notre région, bénéficient.
Si l’on met bout à bout tous ces besoins potentiels et ces fermetures probables de tranches nucléaires historiques, il nous semble que les deux EPR sont largement justifiés et peut-être même qu’une haute ambition industrielle conduirait à en prévoir également un troisième … !
Une production d’électricité décarbonée encore plus massive nous permettrait aussi d’être mieux armés face à la compétition chinoise ou américaine. Elle contribuerait également à maintenir des prix acceptables pour les ménages, même si les tarifs électriques restent tributaires des cours mondiaux. Développons enfin l’argument de la nécessaire complémentarité des ENR et du nucléaire : les ENR, intermittentes par nature, ne peuvent toujours fournir l’électricité au moment où celle-ci doit être consommée. La question se résout par le stockage mais également par des réserves de puissance dont le nucléaire fait partie.
 Conclusion
Conclusion
Les EPR de Gravelines constituent une condition nécessaire à la réindustrialisation et la décarbonation des Hauts-de-France mais aussi de notre pays et de nos voisins. Ils participeront à la poursuite de l’aventure industrielle dunkerquoise qui fait de ce territoire un pôle tourné vers l’avenir et qui porte en son potentiel des ambitions pour le pays entier.
Nous invitons les décideurs, sur la base de notre outil de planification énergétique, à envisager une production électrique plus massive encore, pour répondre aux besoins futurs (usages incompressibles, sobriété difficile à actionner surtout dans de telles proportions, production d’hydrogène, de e-carburants, exportations…) et éviter la sobriété subie, qui serait fortement préjudiciable socialement et économiquement.