Congrès ALLICE : “Decarbonising industry : ramping up for 2030 and beyond !”
Le congrès Allice dresse le bilan d’aujourd’hui par rapport à nos objectifs de 2030, et des obstacles qu’il faudra surmonter pour réussir à atteindre ceux de 2050.
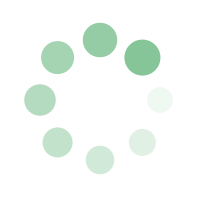
Le congrès Allice dresse le bilan d’aujourd’hui par rapport à nos objectifs de 2030, et des obstacles qu’il faudra surmonter pour réussir à atteindre ceux de 2050.

Le 23 et 24 septembre s’est tenu l’évènement biennal d’ALLICE à Paris avec pour thématique ”Decarbonising industry : ramping up for 2030 and beyond !”. L’objectif de celui-ci est de dresser un bilan d’aujourd’hui par rapport à nos objectifs de 2030, qui est déjà demain, et de commencer à regarder les obstacles qu’il faudra surmonter pour réussir à atteindre ceux de 2050.
Au cours de ces deux journées, se sont enchaînés de nombreux témoignages : retour d’expérience des industriels sur leurs projets de décarbonation, présentation de solutions technologiques déjà opérationnelles ainsi que mise en lumière d’innovations en développement. Le constat partagé est le même que lors du Congrès ALLICE 2023, nous avons actuellement toutes les cartes en main pour réussir à atteindre les objectifs à l’horizon 2030, mais il faut développer celles qui permettront d’atteindre les objectifs fixés à 2050. Cependant, il ne faut pas penser que 2030 est acquis et que nous atteindrons ces objectifs facilement.
Pour rappel, la SNBC 3 (Stratégie Nationale Bas-Carbone) fixe un objectif de -35 % des émissions industrielles entre 2015 et 2030. Selon le rapport Secten 2025 du CITEPA, les émissions 2024 se situent entre les trajectoires prévues par la SNBC 2 et la SNBC 3, comme l’a rappelé Thomas Gouzennes de la Direction Générale des Entreprises. Cependant, la dynamique récente reste fragile : la baisse n’a été que de 1,4 % entre 2023 et 2024, et l’INSEE anticipe une diminution à 1,3 % entre 2024 et 2025. Surtout, ces réductions ne résultent pas d’une véritable transformation structurelle, mais d’un ralentissement de l’activité industrielle dans certains secteurs en difficulté. Autrement dit, nous émettons moins parce que nous produisons moins et non pas parce que nous produisons mieux. Or, c’est bien sur l’intensité carbone de notre production qu’il faut agir : réduire nos émissions nationales au prix d’une hausse des importations plus carbonées reviendrait simplement à déplacer nos émissions, pas à les supprimer.
Que ce soit lors de l’édition 2023 ou 2025 du Congrès ALLICE, nous avons pu assister à la présentation de projets de décarbonation ambitieux en France qui ont abouti, ce qui montre clairement que c’est possible lorsque certains s’engagent :
Souvent, le frein économique a pu être levé grâce à différents dispositifs d’aides (ADEME, CEE, aides régionales, etc.) ou grâce au recours au tiers-financement, ce qui a permis de concrétiser plusieurs projets de décarbonation. Il est essentiel de poursuivre ces efforts pour lever un maximum de freins à l’investissement, en particulier pour les cinquante sites industriels les plus émetteurs, qui représentent à eux seuls deux tiers des émissions industrielles du pays. Le principal obstacle demeure toutefois d’ordre économique.
Adeline Pillet, du Service Décarbonation de l’industrie et hydrogène, a présenté les montants nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’échelle des 225 sites concernés par les plans de transition sectoriels (PTS). Cela représente un besoin d’investissement de 10 milliards d’euros d’ici 2030, dont un tiers consacré à l’efficacité énergétique. Pour faciliter la mise en œuvre de ces investissements, une meilleure valorisation du prix du carbone pourrait jouer un rôle clé. En rendant financièrement plus attractifs les projets de réduction d’émissions, elle permettrait de transformer des initiatives jugées coûteuses en opportunités rentables et compétitives, et peut-être même diminuer le besoin de subvention pour qu’un projet puisse aboutir.
Les projets énergétiques sont encore trop souvent perçus comme une contrainte, abordés sous un angle strictement financier centré sur les économies d’énergie. On ne prend pas toujours le temps de les envisager dans une vision plus globale et stratégique. L’approche des Bénéfices Non Énergétiques (BNE), présentée par Catherine Cooremans lors du Congrès, met justement en lumière l’ensemble des retombées positives indirectes : amélioration de la productivité, réduction des risques, confort des opérateurs, qualité produit, image de marque, etc. Elle rappelle ainsi qu’un projet de décarbonation ne se limite pas à l’énergie, mais influence bien d’autres dimensions de la performance industrielle. On a encore tendance à évaluer un projet uniquement à travers son TRI, plutôt que de le considérer comme un levier de compétitivité à long terme. Pourtant, à partir du moment où un projet est rentable, c’est qu’il est par définition bénéfique pour l’entreprise, au-delà même des économies d’énergie qu’il génère.
L’un des chiffres marquants évoqués par le grand témoin du congrès, Pierre-André de Chalendar, président de La Fabrique de l’Industrie et ancien PDG du groupe Saint-Gobain, illustre bien les enjeux économiques de la transition. Selon la FMI (Fond Mondial International), le coût de la décarbonation représenterait entre 0,5 et 1 point du PIB mondial, tandis que le coût de l’inaction atteindrait jusqu’à 15 points. Ainsi, si la décarbonation implique aujourd’hui un investissement conséquent, le coût de l’inaction serait, à terme, bien plus élevé.